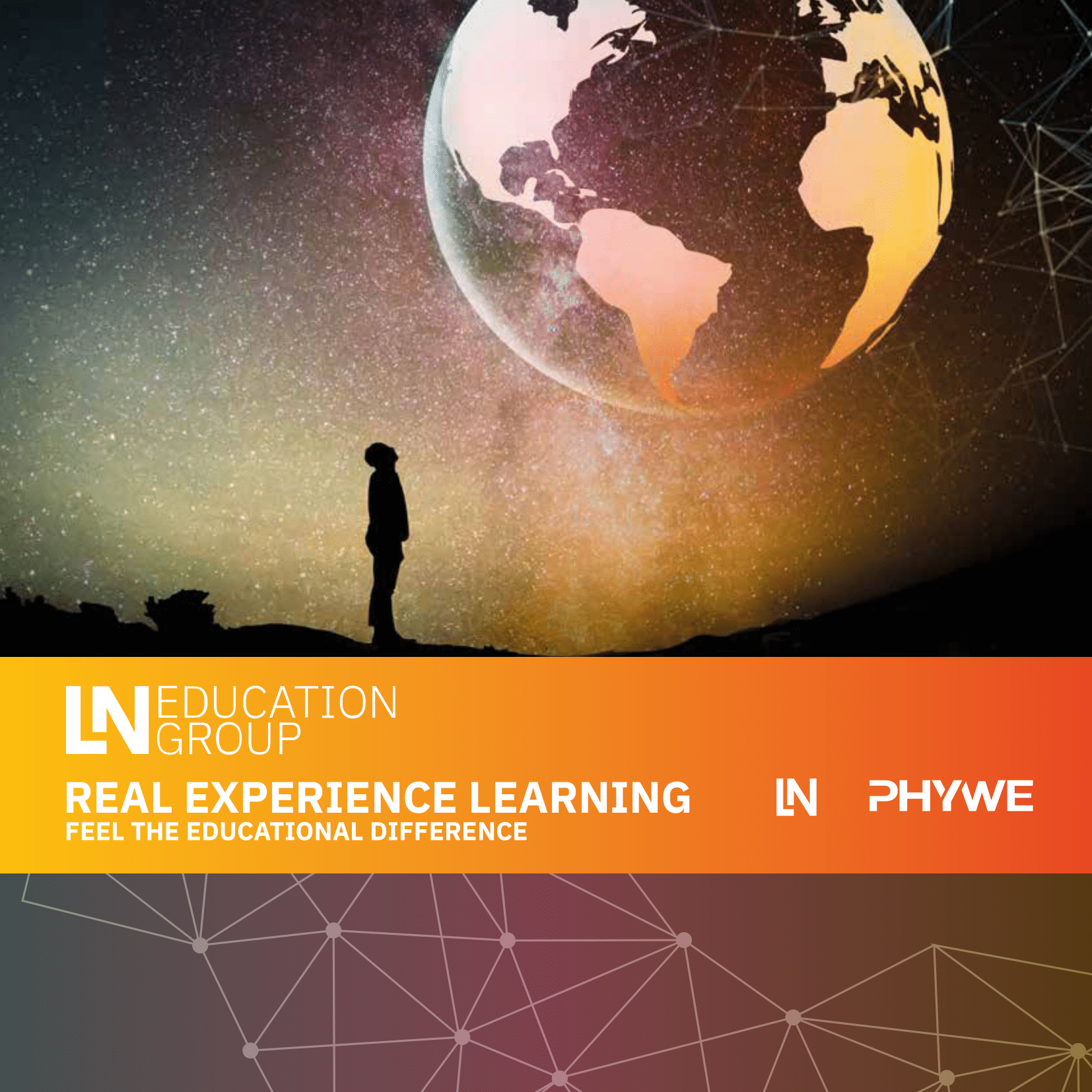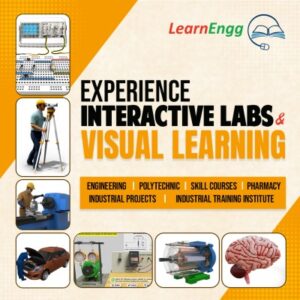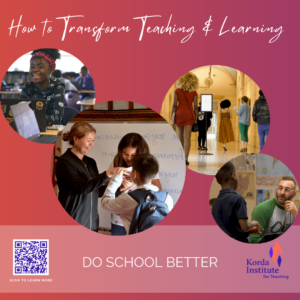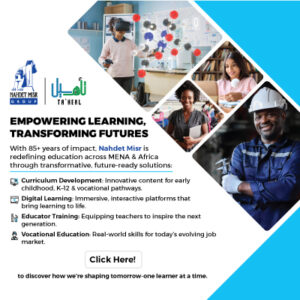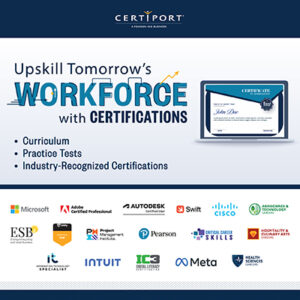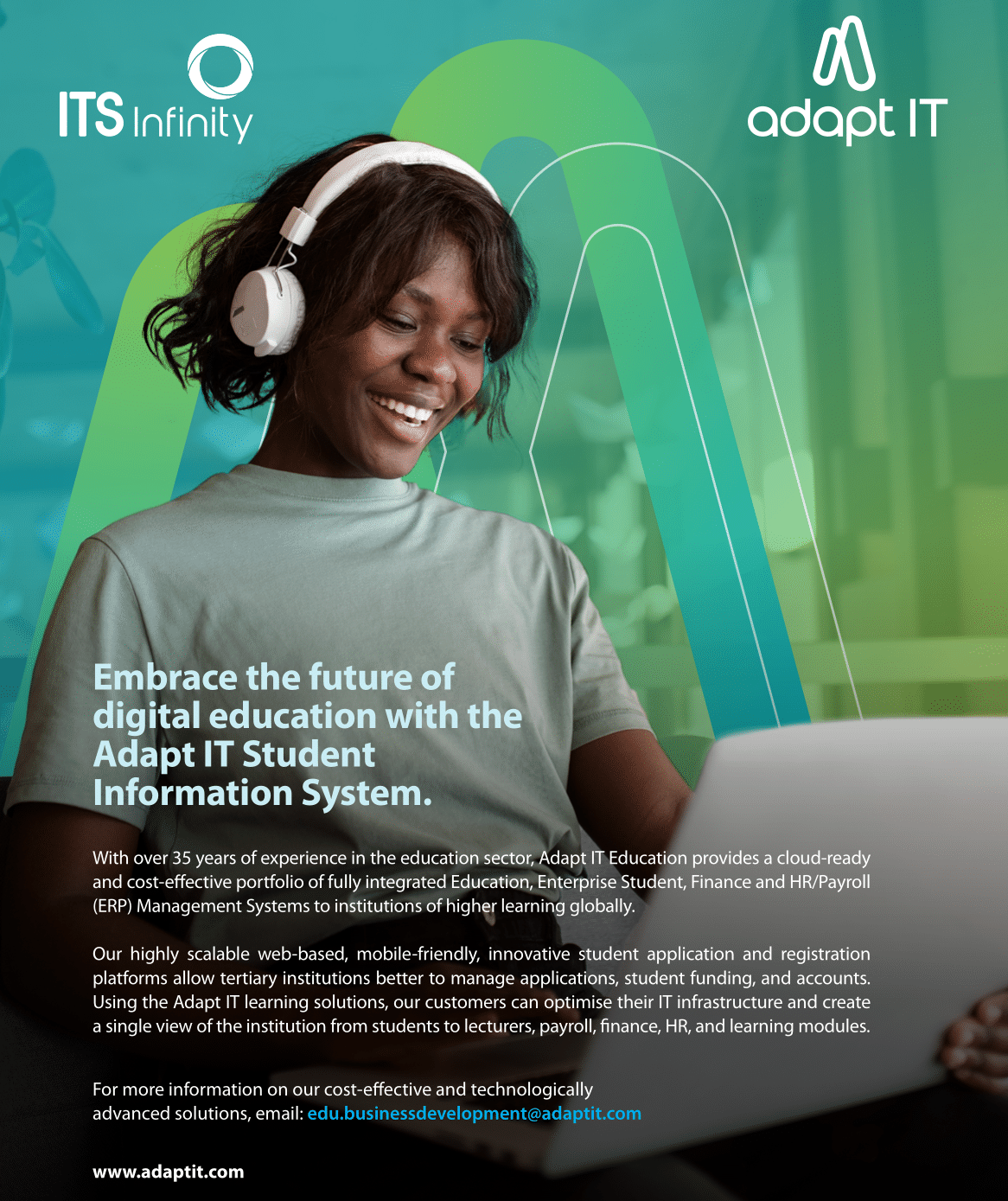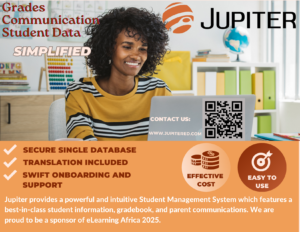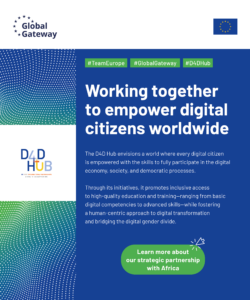Introduction
Redéfinir le développement du capital humain en Afrique va au-delà d’une réforme. C’est une transformation audacieuse des systèmes d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie dans l’optique de favoriser la croissance durable et l’innovation sur le continent. L’édition 2025 de la Table ronde ministérielle (TRM) réunit des décideurs politiques de haut niveau, des experts et des parties prenantes pour examiner trois moteurs interdépendants de cette transformation.
La première session traite de l’enseignement et de la pédagogie pratiques nécessaires pour développer un apprentissage mixte et numérique. La seconde examine les voies et moyens pour l’Afrique de façonner l’IA et s’y préparer, en veillant à l’adapter à ses besoins et à ses ambitions spécifiques. La troisième aborde le pouvoir des données (collecte, interprétation et appliquons) comme pierre angulaire de systèmes éducatifs adaptés à l’avenir.
Le présent document de synthèse offre un aperçu de ces thèmes afin d’encadrer et d’inspirer les discussions prévues à Dar es-Salaam le 7 mai 2025. Il ne vise pas à répondre à toutes les questions, mais inciter à un dialogue ouvert et urgent.
Développer les compétences requises pour un environnement de travail numérique
Énoncée par l’Union africaine, la stratégie de transformation numérique pour l’Afrique (2020-2030) appelle à doter la population active de compétences numériques avancées pour stimuler l’industrialisation et le progrès économique. D’après les prévisions, l’Afrique disposera de la main-d’œuvre la plus jeune et la plus dynamique au monde d’ici 2050. Le moment est donc idéal pour investir dans la culture numérique et les compétences adaptées à l’avenir.
Ce domaine thématique présentera The Digital School et ses académies SkillED – un modèle pionnier pour doter les jeunes de compétences pratiques, prêtes à l’emploi et adaptées aux demandes du marché du travail. Cette approche vise à combler le fossé entre l’éducation et l’emploi, en particulier pour les apprenants marginalisés qui n’ont qu’un accès limité aux systèmes traditionnels.
Présente dans plus de 20 pays répartis sur quatre continents, The Digital School propose des programmes numérisés, une plateforme d’apprentissage dédiée, un contenu numérique accessible, des espaces d’apprentissage sécurisés, des appareils et une connectivité, ainsi qu’un soutien continu aux éducateurs. Ses partenariats avec des organisations telles que le WFP et le Comité international du Croissant-Rouge ont contribué à étendre sa portée et à renforcer son impact.
Les participants seront invités à examiner les possibilités de s’inspirer de ce modèle pour élaborer des approches nationales de développement des compétences et de l’employabilité des jeunes, ainsi que les démarches requises pour reproduire ou adapter cette approche à leurs systèmes respectifs.
Étant donné que les gouvernements souhaitent responsabiliser les jeunes et libérer leur potentiel, la session s’intéressera aux types de compétences réellement nécessaires pour l’avenir numérique de l’Afrique et les moyens d’en assurer l’acquisition à grande échelle.
Préparation de l’Afrique à l’ère de l’intelligence artificielle (IA)
L’IA remodèle rapidement la façon dont les gens apprennent, travaillent, enseignent, rédigent, font de la recherche et gouvernent. Son influence touche aussi bien l’éducation, que l’emploi, les services publics et la vie civique, et l’Afrique ne peut se permettre de rester à l’écart.
Plusieurs pays, notamment le Maroc, le Sénégal, le Bénin, le Kenya et le Rwanda, mènent le peloton de tête en matière de stratégies nationales liées à l’IA. Mais une opportunité majeure consiste à s’assurer que l’IA fonctionne en Afrique, sous l’impulsion d’Africains, conformément aux valeurs et spécificités du continent.
L’IA est déjà utilisée dans les salles de classe africaines, comme le démontrent des outils comme Kwame for Science (assistant propulsé par l’IA qui propose un soutien scientifique et des sujets d’examens antérieurs) ou des applications mobiles qui enseignent le codage en langues locales. Des institutions telles que l’AIMS et le programme AMMI forment une génération de talents africains dans le domaine de l’IA.
Pourtant, il subsiste d’importantes lacunes. Trop de politiques sont déconnectées des réalités de la classe. La stratégie continentale de l’UA en matière d’IA (2023) est une étape décisive, mais sans un plaidoyer structuré, une sensibilisation du public et une coordination intersectorielle, sa mise en œuvre s’essoufflera.
Si l’IA offre des possibilités intéressantes de transformer l’éducation en Afrique, la réalisation de son potentiel dépend de la levée d’obstacles majeurs, qu’il s’agisse de déficits d’infrastructures, de pénuries de compétences ou de problèmes de gouvernance. Il est crucial de prendre en compte la pertinence et la représentativité des données sur lesquelles les systèmes d’IA sont entraînés.
Ce domaine thématique ouvrira une discussion tournée vers l’avenir :
- Quelles sont les exigences concrètes relatives à un système éducatif africain adapté à l’IA ?
- Comment s’assurer que les engagements politiques se traduisent en réalités pédagogiques ?
- Dans quelle mesure les modèles d’IA locaux, développés en langues africaines, peuvent-ils favoriser un apprentissage culturellement pertinent ?
- Comment les pays africains peuvent-iles relever les défis plus profonds liés aux préjugés, à la souveraineté des données et à la gouvernance inclusive de l’IA ?
En outre, la discussion abordera la contribution potentielle d’initiatives telles que la Fondation Open Knowledge et le Partenariat mondial pour les données du développement durable à la localisation et à l’intégration de solutions d’IA adaptées et conçues avec les apprenants, les enseignants et les systèmes africains.
La session incitera surtout les participants à envisager les moyens pour les pays africains de s’approprier leur avenir numérique, grâce aux investissements stratégiques, à une utilisation éthique et à des innovations locales.
Le rôle central des données
Les données sont de plus en plus cruciales dans la prise de décision en matière d’éducation, de la planification nationale à l’apprentissage personnalisé. Si les plateformes numériques génèrent des volumes croissants de données sur l’interaction des élèves avec les contenus et leur progression dans les cours, d’autres informations essentielles proviennent toujours des dossiers scolaires, des rapports d’enseignants, des enquêtes auprès des ménages et des évaluations systémiques. Ensemble, ces sources permettent d’identifier les apprenants à risque, d’orienter un soutien ciblé, et d’élaborer des politiques, des pratiques pédagogiques et des programmes plus efficaces.
Lorsqu’elles sont bien utilisées, les données favorisent une intervention précoce, un apprentissage sur mesure et une amélioration continue. Les techniques telles que l’apprentissage automatique et l’analyse prédictive proposent des outils puissants, mais uniquement lorsque les données sont disponibles, pertinentes et fiables.
Pourtant, à l’échelle du continent, les données sont souvent limitées, incomplètes ou inaccessibles. De nombreux pays ne disposent pas d’infrastructures nécessaires à la collecte et à la gestion à grande échelle de données sur l’éducation. Même lorsqu’elles sont collectées, les données sont souvent stockées dans des centres situés hors du continent, d’où les questions urgentes liées à la propriété, à la souveraineté et au contrôle.
L’exploitation de données personnelles, en particulier celles d’étudiants, ainsi que la protection adéquate de la vie privée, le consentement et la confiance du public soulèvent de plus en plus d’inquiétudes. Le risque de biais, en particulier en cas d’importation ou de contextualisation inadéquate d’ensembles de données, peut fausser les résultats et exacerber les inégalités.
Pour tirer pleinement parti des données, les pays africains doivent investir dans des systèmes robustes, des normes fiables, des cadres de gouvernance solides et des capacités humaines. Ils doivent générer et protéger ces données, mais également bâtir une culture commune d’aisance en la matière, à savoir la capacité de les interpréter, de les communiquer et de les appliquer de façon éthique, avec confiance et efficacité.
Pour renforcer la maîtrise des données dans les systèmes éducatifs, il faut :
- faire preuve d’un raisonnement critique ;
- appliquer les données dans divers contextes ;
- utiliser avec confiance les outils et techniques y relatives ;
- communiquer des idées de manière claire et éthique ;
- faire preuve de discernement pour déterminer le moment adéquat et la méthode d’exploitation des données.
Tout éducateur, décideur ou dirigeant qui maîtrise les données ne se contente pas de les lire : il les utilise naturellement et à bon escient, comme un locuteur qui parle couramment une langue, de manière à améliorer les résultats tout en veillant au respect de l’éthique et à la pertinence en contexte.
Ce domaine thématique examinera les moyens pour les pays africains de prendre le contrôle de leur avenir en matière de données. Il s’agira de renforcer leurs capacités à générer, gouverner et appliquer des données de manière efficace, d’améliorer les systèmes, d’élaborer leurs propres normes et d’user des données de manière à servir les apprenants, à protéger les droits et à favoriser une meilleure prise de décision.