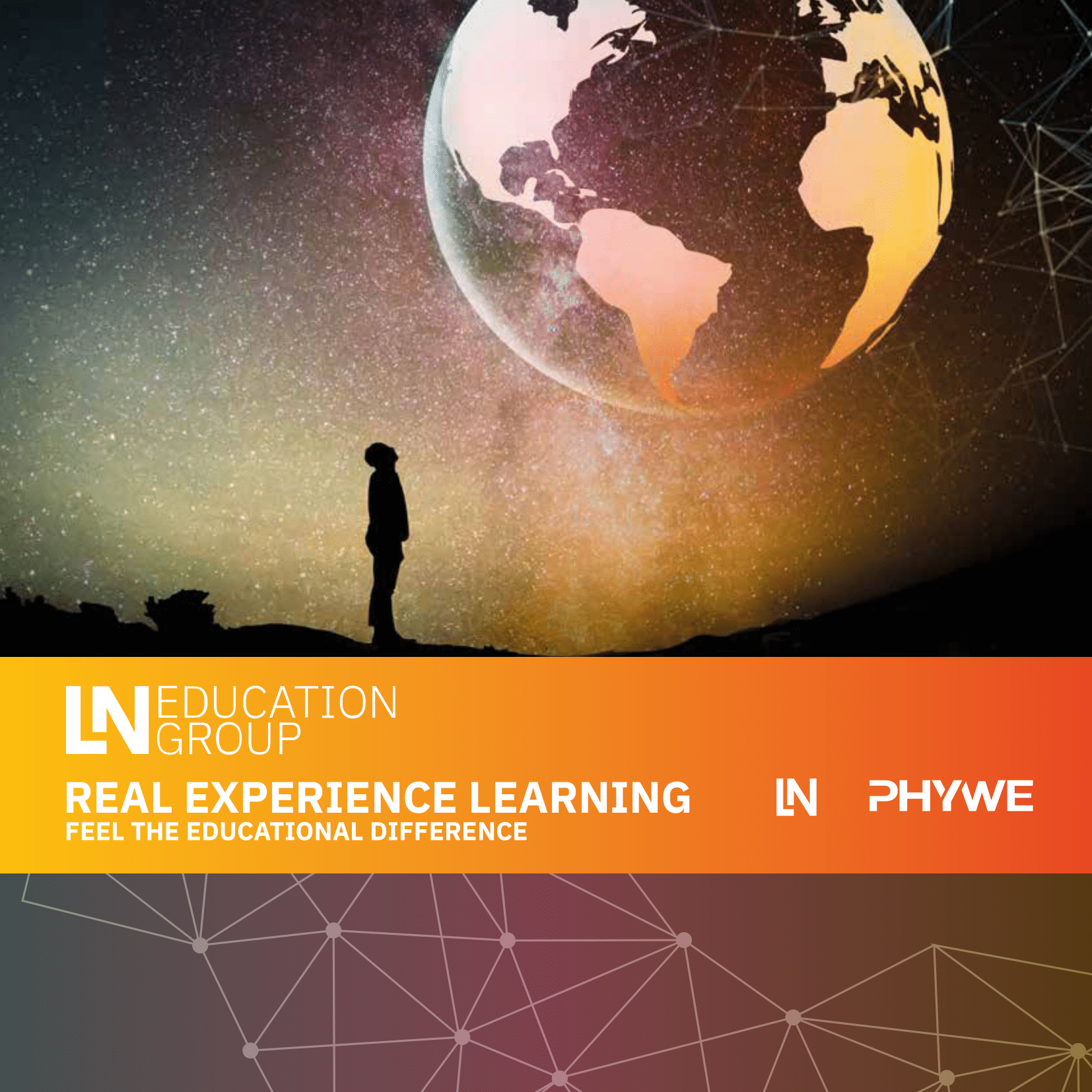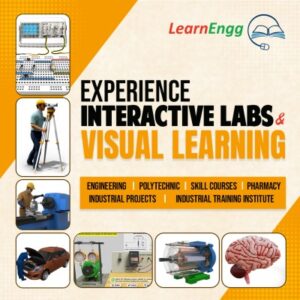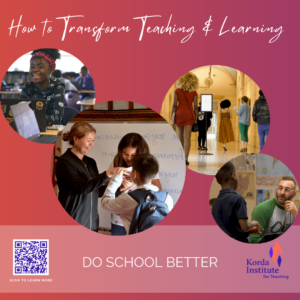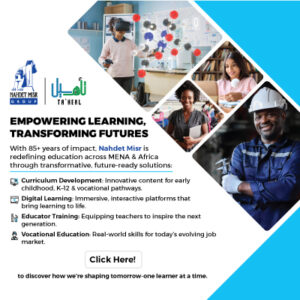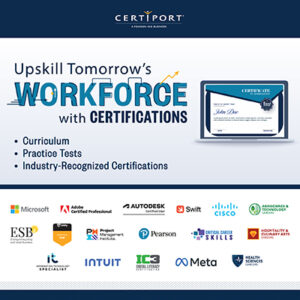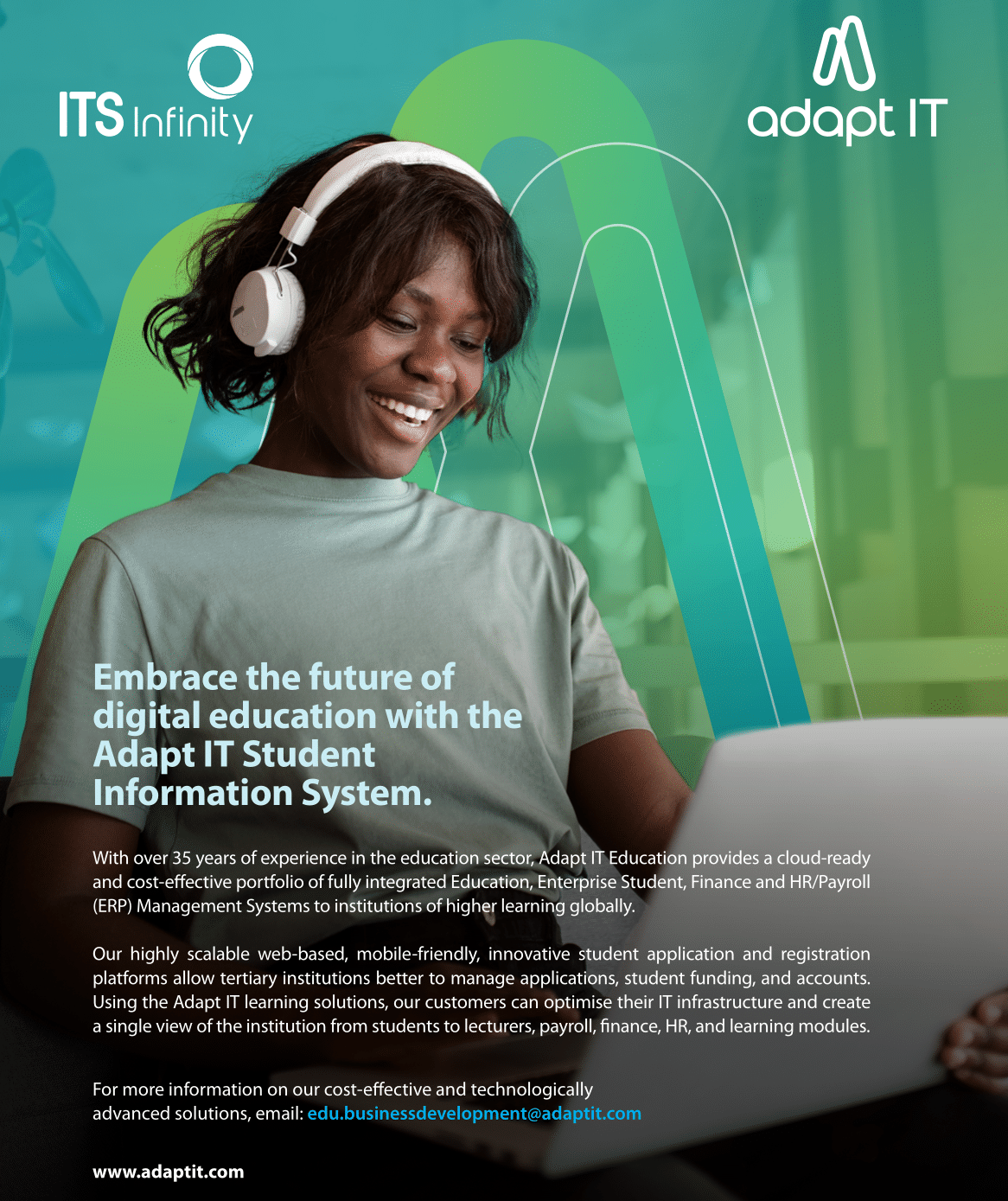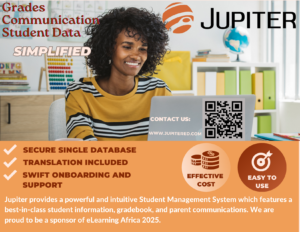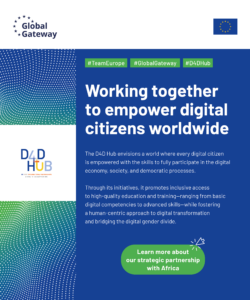14 juillet 2025
Par Jim Plamondon, PDG de la Spix Foundation
À première vue, l’idée semble improbable.
L’Afrique – un continent trop souvent associé aux gros titres sur la pauvreté, le manque d’infrastructures et la dépendance à l’aide internationale – qui prétend pouvoir devenir un exportateur mondial de cours interactifs numériques en seulement cinq ans.
Pour beaucoup, cela ressemble à un slogan creux ou à un vœu pieux entendu lors de conférences internationales. Après tout, l’écosystème EdTech africain lutte depuis des décennies pour dépasser le stade de projets pilotes. De nombreux innovateurs ont développé des applications brillantes, adaptées aux contextes locaux, mais ont échoué à grande échelle à cause de la connectivité instable, de standards fragmentés et de modèles économiques incapables de survivre sans subventions.
Alors, quand le projet de Vision et Plan Afrique EdTech 2030 ose affirmer que le continent peut passer du statut de consommateur à celui de fournisseur mondial de contenus d’apprentissage numériques en seulement cinq ans, cela mérite qu’on s’y attarde sérieusement.
Et une fois qu’on gratte sous la surface, l’idée semble beaucoup moins irréaliste.
En effet, alors que l’Europe discute encore de la nécessité d’une Infrastructure publique numérique (DPI) pour l’éducation, l’Afrique, elle, est déjà en train de la construire. Et c’est peut-être là son atout secret.
Pourquoi le « business as usual » a échoué pour l’EdTech
Depuis des décennies, les innovateurs EdTech africains se heurtent au même mur : la mise à l’échelle.
Un développeur au Ghana ou au Kenya crée une application de mathématiques brillante. Elle fonctionne à merveille dans une région. Les enseignants l’adorent, les élèves s’y engagent, les bailleurs de fonds s’enthousiasment.
Puis la réalité reprend ses droits :
- Aucun standard technique commun. Chaque ministère de l’Éducation utilise ses propres formats de données, API et protocoles. L’intégration dans les systèmes nationaux exige des réécritures coûteuses et des années de négociation.
- Pas d’infrastructure “offline first”. Dans de nombreuses régions, la connectivité reste irrégulière, chère ou inexistante. Les applications qui reposent sur le cloud ou le streaming échouent en dehors des zones urbaines.
- Un casse-tête de localisation. La diversité linguistique de l’Afrique est fascinante, mais chère à gérer. Traduire les interfaces et contenus suppose souvent une refonte totale pour chaque langue et contexte culturel.
Ainsi, lorsqu’une petite équipe tente de s’étendre du Kenya au Nigeria, ou du Sénégal à l’Éthiopie, les obstacles se multiplient. Ce qui a fonctionné dans un pays s’avère souvent impossible à reproduire dans un autre. Résultat : d’innombrables idées géniales restent bloquées au stade de projet pilote.
Le diagnostic du projet de Vision et Plan Afrique EdTech 2030
Contrairement à beaucoup de documents stratégiques précédents, la Vision et Plan Afrique EdTech 2030 de l’AUDA-NEPAD est étonnamment lucide :
« Le modèle économique de l’EdTech est brisé, en raison de deux problèmes fondamentaux : l’absence de données objectives, fiables et en temps réel pour identifier les meilleurs contenus, et des barrières techniques, politiques et commerciales qui empêchent la diffusion des outils performants. »
La Vision ne consiste donc pas simplement à créer plus d’applications ou de plateformes, mais à abaisser les barrières systémiques qui freinent l’expansion des innovations à travers le continent.
Pour cela, le Plan propose :
- Un cadre politique établissant des standards pour l’interopérabilité, la gouvernance des données, la protection de la vie privée et la souveraineté numérique.
- Une stratégie de données permettant la fédération de données d’apprentissage fines, respectueuses de la vie privée, à l’échelle régionale et continentale pour la recherche et l’amélioration continue.
Mais ces objectifs politiques et de données exigent une mise en œuvre technique. C’est là qu’intervient l’Infrastructure publique numérique pour l’éducation (DPI).
La DPI africaine pour l’éducation : le moteur logiciel de la Vision
Alors que la vision et le plan établissent le modèle, l’IAP pour l’éducation en Afrique est le moteur logiciel qui permet de le concrétiser.
Elle :
- Met en œuvre le cadre politique à travers des API et protocoles ouverts et normalisés.
- Permet l’interopérabilité transfrontalière : une application développée dans un pays peut fonctionner sans friction dans un autre.
- Intègre des mécanismes de protection de la vie privée et de contrôle souverain des données tout en permettant leur fédération pour obtenir des analyses continentales.
- Fournit des outils pour rendre les applications utilisables hors ligne et sur des appareils peu performants, garantissant l’inclusion de tous les apprenants.
Plutôt que de multiplier les systèmes incompatibles, la DPI fournit une ossature commune qui permet aux innovations de se déployer à grande échelle.
Il s’agit de l’étape la plus importante pour transformer l’Afrique d’un consommateur d’EdTech en un fournisseur mondial d’EdTech.
S’inspirer de l’exemple Android
Prenons Android : aujourd’hui, plus de 70 % des smartphones dans le monde fonctionnent sous Android – non pas parce que Google possède chaque appareil, mais parce que Android est libre et open source. Tout fabricant peut l’utiliser sans payer de licence. Les développeurs peuvent créer une application une seule fois, en étant sûrs qu’elle fonctionnera sur des millions d’appareils.
Avant Android, les développeurs mobiles devaient réécrire leurs applications pour chaque marque et modèle : la fragmentation tuait l’innovation.
La DPI africaine pour l’éducation vise un effet similaire :
- Open source, pour permettre aux ministères, opérateurs télécoms et développeurs de l’adopter sans frais propriétaires.
- Conçue pour l’échelle, afin que les applications éducatives fonctionnent partout.
- Basée sur l’interopérabilité, grâce à des technologies standardisées à l’échelle internationale.
- Prévue pour la localisation : un cours compatible DPI pourrait être localisé par un tiers indépendant, par exemple un enseignant.
- Bientôt adaptée au “mapping” curriculaire : il sera très facile de mapper un cours à n’importe quelle norme curriculaire nationale.
Tout comme Android a transformé le développement d’applications mobiles en une industrie évolutive, le DPI africain a le potentiel de faire la même chose pour les programmes de cours EdTech.
L’architecture “offline first” : indispensable, pas optionnelle
L’un des atouts clés de la DPI est son architecture hors ligne par défaut.
Dans de nombreuses zones d’Afrique, la connexion permanente reste un luxe. La data coûte cher. Les réseaux sont instables.
La DPI prend en compte cette réalité en intégrant :
- La distribution de contenus et le stockage de données sur microSD pour les écoles sans Internet.
- Des protocoles “store-and-forward” pour transférer les données dès qu’une connexion est disponible.
- Des caches HTML, serveurs proxy, réseaux maillés et autres technologies bien connues que la DPI implémente une seule fois pour que chaque application n’ait pas à le faire.
Cela garantit qu’un élève du Mali rural ou du nord du Kenya puisse utiliser le même contenu interactif de qualité qu’un élève à Accra.
Sans infrastructure hors ligne, l’avenir numérique de l’Afrique resterait l’apanage des élites urbaines. Le DPI permet à l’apprentissage numérique de devenir véritablement universel.
Fédération des données, pas centralisation
Un autre élément transformateur du DPI est son approche des données.
Chaque pays conserve la souveraineté sur ses propres données éducatives. Mais les données anonymes et agrégées peuvent être fédérées à l’échelle du continent, ce qui permet d’améliorer la qualité de l’enseignement :
- Comparer ce qui fonctionne dans différents contextes.
- Identifier les meilleures pratiques.
- Diffuser rapidement les innovations.
Ce modèle s’inspire de la manière dont les systèmes de santé tels que le DHIS2 fonctionnent à l’échelle mondiale, en équilibrant le contrôle local et les informations régionales.
Bien que ces caractéristiques soient futuristes, le DPI africain est construit avec cette modularité à l’esprit.
Pourquoi l’Afrique pourrait dépasser le Nord global
Paradoxalement, le manque d’infrastructures héritées pourrait devenir un avantage. L’Europe et les Amériques disposent de systèmes anciens difficiles à remplacer. Leurs ministères de l’Éducation restent enfermés dans des plateformes propriétaires et des silos de données. La discussion sur la DPI progresse, mais la mise en œuvre tarde.
L’Afrique, elle, dispose de moins de systèmes figés. Elle peut construire une infrastructure moderne dès aujourd’hui, conçue spécifiquement pour :
- Les contextes multilingues.
- La connectivité intermittente.
- L’harmonisation transfrontalière.
En adoptant dès maintenant une DPI continentale, l’Afrique pourrait créer le premier écosystème EdTech interopérable à grande échelle dans le monde.
Une Opportunité Mondiale
Une grande partie du Sud global fait face aux mêmes défis : systèmes fragmentés, diversité linguistique, faible connectivité, budgets serrés.
Si l’Afrique prouve qu’une DPI éducative peut fonctionner, elle pourrait devenir exportatrice non seulement de contenus EdTech, mais aussi de l’infrastructure elle-même.
On pourrait imaginer des applications éducatives africaines – et le cadre DPI développé en Afrique – servant des écoles en Asie du Sud, en Amérique latine et ailleurs, et faisant tourner les meilleurs contenus produits sur le continent. C’est ainsi qu’une affirmation “audacieuse” – l’Afrique pourrait devenir exportatrice mondiale d’EdTech en cinq ans – commence à sembler non seulement possible, mais logique.
Conclusion
En matière de DPI pour l’éducation, l’Afrique n’a pas à rattraper son retard. Elle est déjà en avance.
Jim Plamondon est PDG de la Spix Foundation, qui développe depuis plus d’un an une DPI éducative alignée sur la Vision. Cette initiative s’appuie sur le travail de Mike Dawson, CTO intérimaire de Spix et PDG d’Ustad Mobile, qui code des solutions EdTech pour les régions à faibles ressources depuis plus de vingt ans.