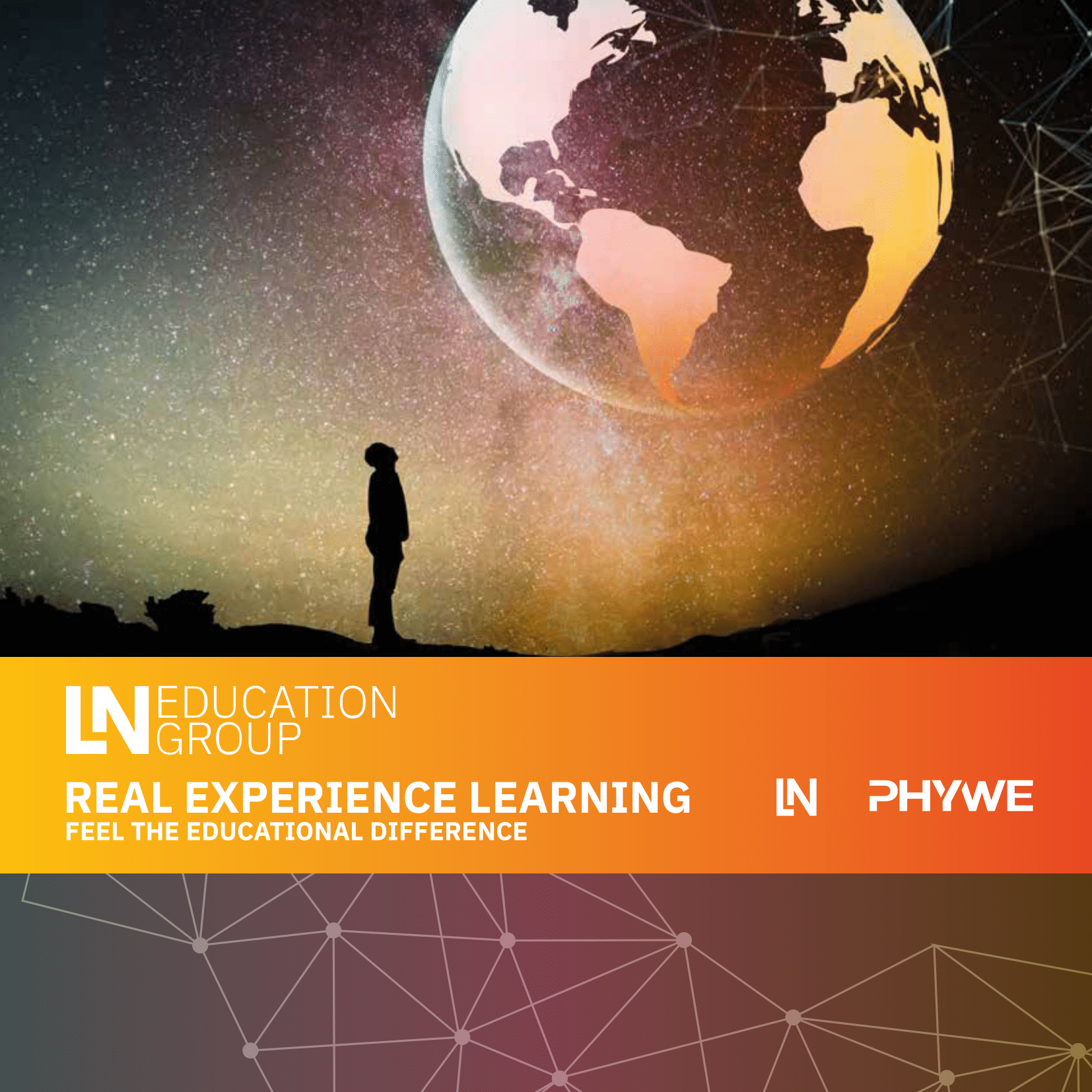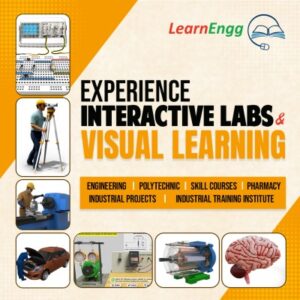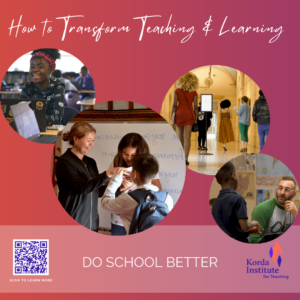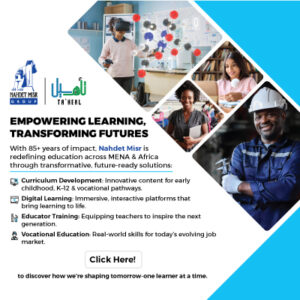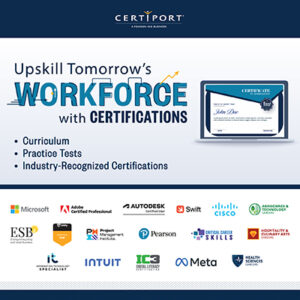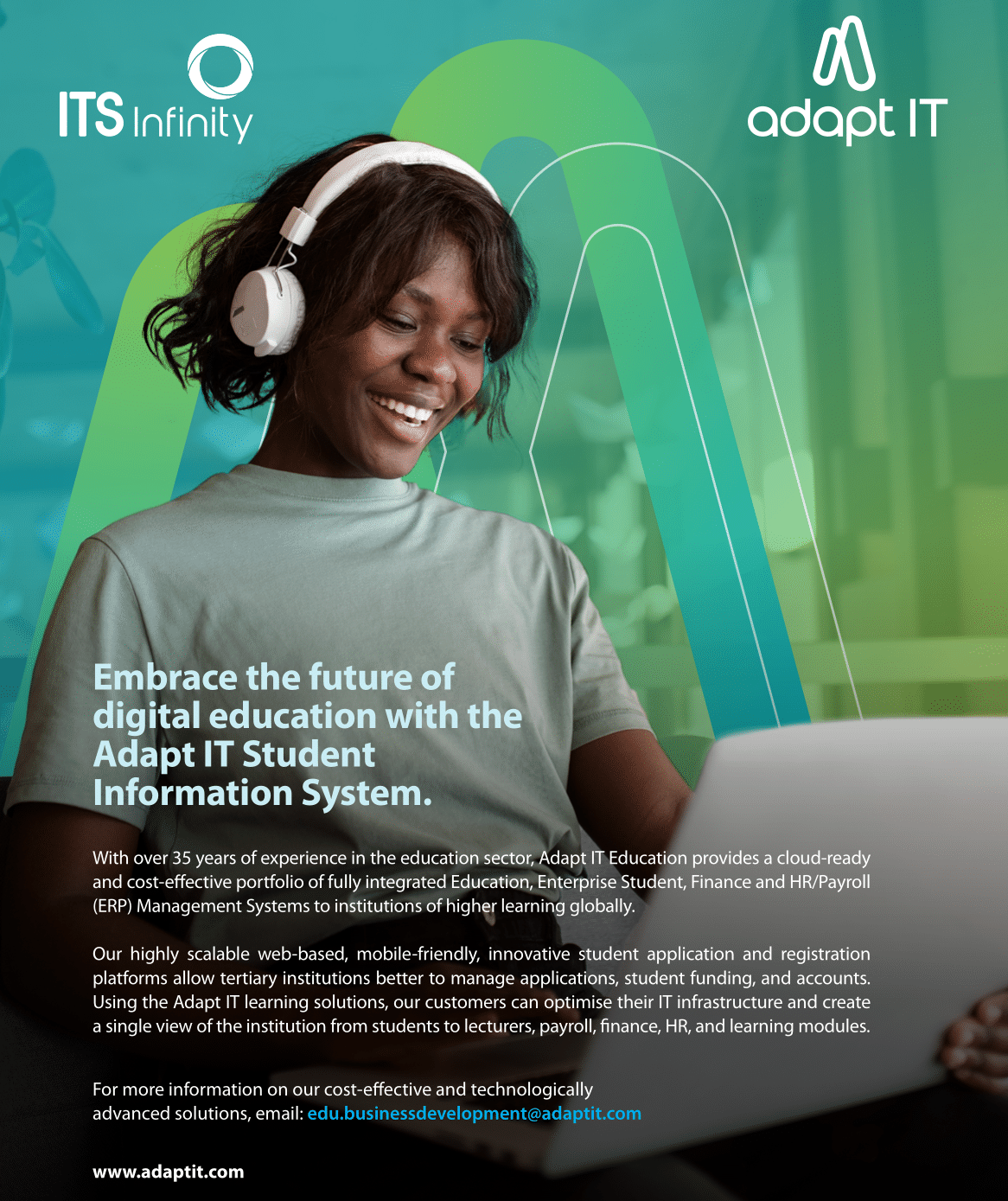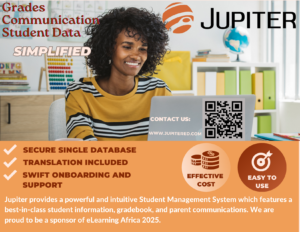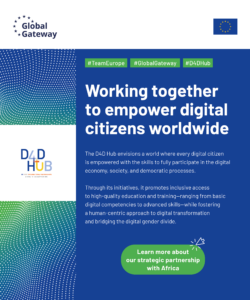Dans les réunions de haut niveau à travers l’Afrique, qu’il s’agisse de forums politiques ou de conférences sur le développement, le débat sur l’avenir numérique du continent est vivant et animé. Les discussions portent notamment sur la mise à l’échelle, l’innovation et les partenariats public-privé nécessaires à la croissance du secteur. Plus récemment, l’attention s’est tournée vers les stratégies en matière d’intelligence artificielle et leur capacité à réduire la fracture numérique.
Pourtant, malgré toute cette effervescence, un élément crucial manque constamment à la table : les voix des acteurs de terrain. Nous construisons l’avenir de l’Afrique sans les véritables architectes – ceux qui connaissent le terrain, les développeurs qui créent les outils, et les étudiants et enseignants qui les utilisent chaque jour.
J’ai eu le privilège de siéger à ces tables, en contribuant à la stratégie continentale de l’Union africaine à travers des consultations avec l’AUDA-NEPAD. Mais mon parcours n’a pas commencé dans une salle de réunion. Il a commencé avec un diplôme en statistiques et en mathématiques, qui m’a appris à voir les problèmes et les solutions. J’ai compris que bon nombre des défis africains exigeaient des investissements lourds en capital, souvent dépendants de technologies et d’expertises importées. Mais j’ai aussi vu que les solutions technologiques pouvaient être moins coûteuses à construire localement tout en offrant des données précieuses pour la planification et les prévisions. Cette prise de conscience m’a poussé vers la création de solutions concrètes, d’une plateforme d’autonomisation des femmes à des sites de commerce en ligne pour des entreprises ghanéennes locales.
Cette expérience pratique m’a donné une perspective souvent en décalage avec les discours académiques ou politiques dominants. Elle repose sur une vérité simple : on ne peut pas concevoir une solution pour un monde que l’on ne comprend pas.
Le fossé entre la politique et la pratique
Le paysage actuel de l’EdTech illustre parfaitement ce décalage. Nous avons des universités équipées de laboratoires informatiques remplis d’ordinateurs inutilisés, faute d’expertise pour les exploiter.
En parallèle, des développeurs talentueux à travers le continent recréent encore et encore les mêmes systèmes de base – comme les portails d’authentification des utilisateurs – gaspillant ainsi un temps et des ressources précieux. Nous travaillons en silos, réinventant la roue à Nairobi, Accra ou Lagos, alors que le code est identique. Cette fragmentation constitue notre plus grand obstacle à la mise à l’échelle.
De plus, une grande partie de l’innovation est guidée non pas par les priorités africaines, mais par des cadres externes comme les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
Certes, en 2015-2016, la plupart des initiatives de développement en Afrique s’alignaient sur ces ODD. Bien que bien intentionnée, cette approche a créé une profonde déconnexion.
Un exemple frappant est celui des technologies dans le secteur de la santé : une application de télémédecine visant à améliorer la santé maternelle correspond parfaitement à un objectif des ODD, mais elle ne tient pas compte de la réalité d’un village rural où une mère ne peut même pas se permettre d’acheter un simple repas ou du savon pour laver les vêtements de son enfant.
Une technologie bien intentionnée, certes, mais déconnectée des réalités socio-économiques sous-jacentes.
Tant que nous ne parviendrons pas à convaincre nos développeurs les plus brillants d’aligner leur vision sur les priorités locales, nos solutions ne feront qu’effleurer les problèmes sans jamais atteindre l’échelle nécessaire.
Un appel à une collaboration radicale et à des voix brutes
L’avenir de l’EdTech ne passe pas par une stratégie descendante, mais par un changement fondamental vers une collaboration pratique et incitative. Il s’agit de créer un cadre où les gouvernements offrent des incitations – comme des réductions fiscales ou des crédits – pour encourager et soutenir les partenariats public-privé. De cette manière, l’Afrique pourra briser les silos, renforcer les capacités institutionnelles et mobiliser les ressources de manière intelligente.
Mais surtout, il faut s’assurer que les bonnes personnes soient dans la pièce lorsque les politiques sont élaborées. Avec l’émergence de l’IA et des nouvelles technologies, nous devons nous appuyer sur des données en temps réel pour prendre nos décisions, plutôt que sur des rapports trimestriels.
L’élaboration des politiques doit être globale, intégrant les points de vue des décideurs, des enseignants, des développeurs et des étudiants. Les retours bruts, directs et en temps réel sont essentiels. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons passer d’une logique de réaction – simplement rapporter le passé – à une logique de prévision. Identifier les tendances, repérer les schémas, et orienter les ressources là où elles auront le plus d’impact.
Construire un avenir authentique et afrocentrique
L’opportunité qui s’offre à nous est immense. Avec la montée de l’IA, la création est plus rapide et plus accessible que jamais. Nous n’avons plus besoin de tout reconstruire de zéro : d’innombrables outils et bibliothèques sont à notre disposition. Mais la technologie n’est qu’un outil. Nous devons l’adapter à notre propre style, notre propre contexte, notre propre façon de faire pour garantir une adoption fluide. Construire une solution afrocentrique ne consiste pas à coller des images africaines sur une application générique, mais à comprendre profondément nos capacités et nos réalités, puis à créer en fonction d’elles.
C’est la vision qui anime des initiatives comme Project RESPECT™ de la Fondation Spix, une plateforme créée par des Africains, pour des Africains. Elle crée un écosystème gagnant-gagnant, offrant aux développeurs un soutien technique, une validation par les systèmes éducatifs locaux et un accès direct à des sources de revenus. En parallèle, elle offre aux étudiants une expérience d’apprentissage de qualité, engageante et culturellement pertinente. C’est un modèle qui comprend le défi des deux côtés de l’équation.Au fond, il ne s’agit pas seulement de technologie. Il s’agit d’inspirer les développeurs africains à construire pour leur continent, à croître pour leur continent, et à créer des solutions qui servent leurs communautés locales. Mes moments les plus gratifiants ne viennent pas du lancement d’un produit, mais de la puissance des gens qui se rassemblent pour résoudre un problème qui les touche directement. Si nous écoutions davantage les histoires réelles et les chiffres réels, nous ne construirions pas seulement de meilleures applications – nous construirions l’avenir que nous méritons tous.
Par Joseph Berkoh